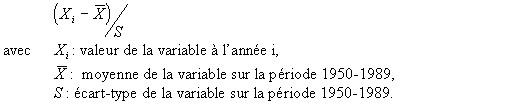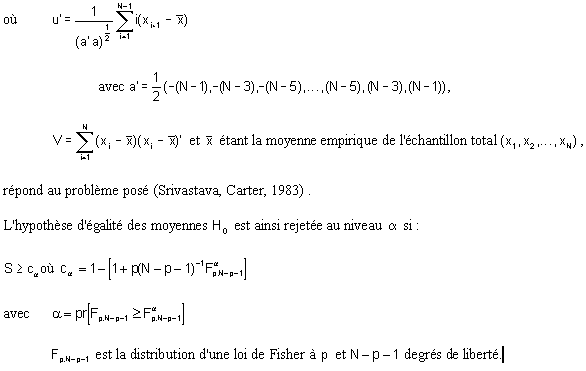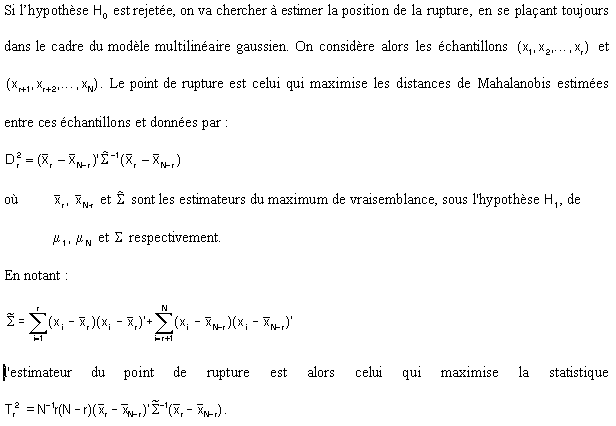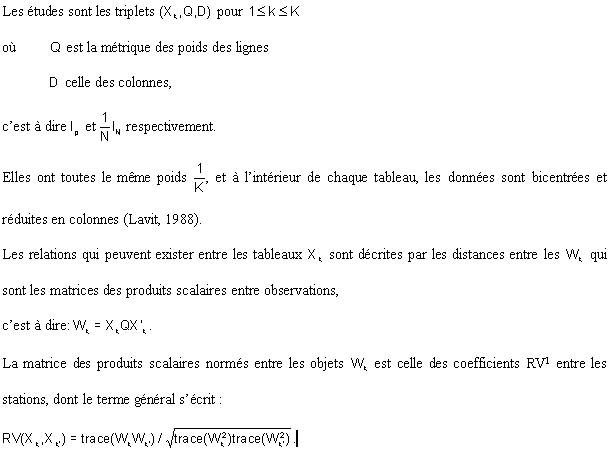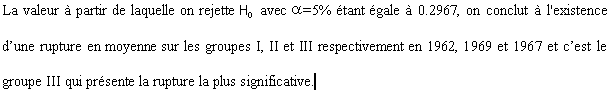Synthèse
DONNEES ET
METHODES
Données de base
Les données pluviométriques journalières de nombreux postes
d'Afrique de l'Ouest et Centrale ont été utilisées pour élaborer les
variables étudiées. Dans certains cas, celles-ci peuvent être obtenues
très simplement. La pluviométrie annuelle ou mensuelle se définit par
exemple comme un simple cumul de données journalières ou mensuelles.
Parfois, cependant, les variables traitées font référence à une
définition plus complexe telles que les dates de début et de fin des
saisons des pluies. Certains problèmes ont parfois accompagné la
définition des variables :
- indisponibilité occasionnelle de certaines des données nécessaires,
- erreurs manifestes de saisie constatées dans certain cas : rosée
comptée comme pluie; cumul pluviométrique non ou mal indiqué, etc.
Un important travail de collecte et de critique a donc été réalisé. Il
s’appuie principalement sur trois sources d’information :
- les données pluviométriques journalières contenues dans la base «
PLUVIOM » gérée à Montpellier par l’ORSTOM,
- les résultats des travaux effectués par l’ORSTOM et l’ASECNA pour
le CIEH dans le cadre de la publication des relevés de précipitations
journalières de l’origine des stations jusqu’en 1980,
- les contacts nombreux avec différents services nationaux et
d’autres équipes de recherche (qu’ils en soient tous remerciés).
Une base de données très complète (HEP-BASE), gérée sous PARADOX, a
ainsi été constituée. Elle couvre l’ensemble de la zone étudiée depuis
l’implantation des postes pluviométriques jusqu’à la fin de la décennie
1980.
Globalement, à quelques exceptions près, l’information
pluviométrique disponible est journalière pour les pays francophones et
mensuelle pour les autres pays.
La sélection des postes analysés repose sur des critères de
qualité des données et de longueur des séries pluviométriques. La
quantité d’information retenue varie beaucoup d’un pays à l’autre comme
on le verra au cours de l’analyse des différents résultats obtenus au
cours de l’étude.
La période d’étude retenue est centrée autour de l’année 1970
puisque cette date semble être celle à partir de laquelle on a pu
observer une fluctuation du climat qui se fait encore ressentir dans les
régions d’Afrique de l’Ouest et Centrale. Afin de travailler à partir de
séries chronologiques suffisamment longues et nombreuses et en fonction
des données disponibles, l’étude a concerné principalement les décennies
1950, 1960, 1970 et 1980.
Méthodes
Différentes méthodes, qui sont présentées ici, ont été
utilisées tout au long de cette étude.
Dans la mesure du possible, on a privilégié deux approches
différentes mais complémentaires :
- à un niveau ponctuel, pour chaque station, des méthodes
statistiques permettant de caractériser des fluctuations dans une série
chronologique ont été utilisées.
- les méthodes statistiques retenues dans le cadre de ce travail sont
: test de corrélation sur le rang pour vérifier le caractère aléatoire
d’une série, test de Pettitt, statistique de Buishand, ellipse de
contrôle, procédure bayésienne de Lee et Heghinian et procédure de
segmentation des séries hydrométéorologiques de Hubert pour détecter une
rupture au sein d’une série.
- à un niveau régional, l’évolution de la variable étudiée
durant les décennies 1950, 1960, 1970 et 1980 a été cartographiée.
- pour chacune des décennies, la variable a été cartographiée sur la
zone étudiée, à chaque fois à partir des mêmes postes.
- Sur chacun des postes retenus, on a déterminé un indice annuel de
la variable défini comme une variable centrée réduite (Nicholson et al,
1988; Servat, 1994) :
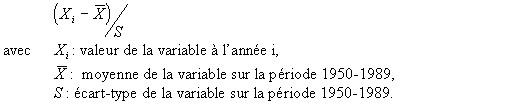
Pour
chacune des décennies, une moyenne par décennie des indices annuels
calculés a été cartographiée, à chaque fois à partir des mêmes postes.
La carte ainsi obtenue traduit des zones à déficit ou excédent de la
variable plus ou moins marqués.
MISE EN EVIDENCE
D’UNE VARIABILITE PLUVIOMETRIQUE ANNUELLE
La pluviométrie
annuelle a notablement changé au cours des dernières décennies en
Afrique de l’Ouest et Centrale comme en peuvent témoigner les cartes de
pluviométrie annuelle et d’indices pluviométriques (figure 1 et figure 2) au cours des
quatre dernières décennies.
Les précipitations
annuelles ont diminué de façon très importante sur l’Ouest et le Nord de
la zone d’étude, ainsi que sur la façade océanique de la Côte d’Ivoire.
Ailleurs, cette diminution est vérifiée également mais plus faiblement.
Cette variation semble être apparue à la fin de la décennie 1960
et au tout début de la décennie 1970 (figure 3).
Ses effets se font donc ressentir depuis plus de deux décennies et
semblent même s’être accrus durant la décennie 1980.
Dans l’état
actuel des connaissances, les raisons d’un tel phénomène ne sont pas
déterminées. Il est toutefois intéressant de noter en Côte d’Ivoire la
coïncidence et la concomitance entre la baisse de la pluviométrie dans
le sud forestier d’une part et la déforestation et la mise en culture de
cette région d’autre part. Cette constatation est conforme au consensus
qui semble se dégager aujourd’hui à propos de l’influence humaine sur le
climat (Houghton, 1996).
Les analyses qui suivent ont pour
objectif de préciser les formes de cette variabilité pluviométrique.
ANALYSES UNIVARIEES DE LA VARIABILITE PLUVIOMETRIQUE
Le
tableau 1 résume les résultats d’analyse des
principales variables étudiées.
Certains résultats ne couvrent
parfois que partiellement la zone d’étude : les pays anglophones (Ghana,
Liberia, Nigeria et Sierra Leone) n’ont pas pu être traités du fait de
l’impossibilité d’y élaborer certaines variables étudiées, celles-ci
nécessitant, en effet, des données de base au pas de temps journalier.
Evolution de la cartographie des zones pluviométriques
Le
régime des pluies conditionne les principales variations climatiques. La
région étudiée couvre des zones à climat assez différents.
L’influence de la latitude y est prépondérante et permet une
superposition en bandes parallèles des différents climats, soit
globalement :
- Le climat équatorial qui s’étend au Sud du Cameroun et au Sud-Ouest
de la Centrafrique. Il se caractérise par une pluviométrie pratiquement
permanente durant toute l’année même si le profil pluviométrique annuel
présente une alternance de saisons humides et de saisons moins humides
(il pleut tout de même plus de 100 mm par mois pendant la « petite
saison sèche »!). Le climat que l’on retrouve le long du Golfe de
Guinée, de la Sierra Leone à la Côte d’Ivoire, s’en rapproche beaucoup.
- Le climat tropical humide qui est proche du climat équatorial. Les
précipitations sont abondantes mais elles sont entrecoupées de 2 saisons
sèches (globalement, « grande saison sèche » entre Décembre et Avril et
« petite saison sèche » en Août-Septembre). Ce type de climat se
retrouve de la Guinée à la Centrafrique.
- Le climat tropical sec (qu'il soit de type guinéen ou
soudanien) se caractérise par une saison sèche qui s’allonge. La petite
saison sèche n’existe plus. Il couvre toute la partie Nord (au dessus du
10ème parallèle) de la zone d’étude.
Deux types de régimes pluviométriques coexistent donc dans
la région étudiée. Au Nord et à l’Ouest, on ne rencontre qu’une saison
des pluies au cours de l’année alors qu’en bordure du Golfe de Guinée et
plus à l’Est, on en rencontre deux. La limite entre ces deux secteurs
est assez floue. Une zone qualifiée d’intermédiaire entre la zone à une
saison des pluies et celle à deux saisons des pluies, a donc été
définie.
L’évolution des zones à 1 saison des pluies, des zones
à 2 saisons des pluies et des zones intermédiaires durant les décennies
1950, 1960, 1970 et 1980 a été cartographiée (figure
4). Pour chacune des décennies, le maximum d’information disponible
a pu être utilisé : les postes reportés sur les cartes ne sont donc pas
systématiquement les mêmes d’une décennie à l’autre.
Sur l’ensemble des pays étudiés, seuls 3 pays de l’Afrique de
l’Ouest bordant le Golfe de Guinée (Côte d’Ivoire, Togo et Bénin) ont
connu des modifications notables. Pour les pays retenus de l’Afrique
Centrale, on ne note rien de réellement significatif.
Durant les
décennies 1950 et 1960, la zone à 1 saison des pluies (en 1950 et
1960) s’est étendue progressivement vers le Sud en direction du littoral
du Golfe de Guinée. En Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin, la limite de
cette zone s’est déplacée vers le Sud d’une centaine de kilomètres de la
décennie 1950 à la décennie 1980. Le littoral reste toutefois une zone à
2 saisons des pluies. La zone que l’on a qualifiée d’intermédiaire a
connu son extension maximale durant la décennie 1960. Rappelons que
cette décennie semble avoir été particulièrement pluvieuse dans
l’ensemble de cette sous-région.
Décalage des saisons des
pluies et des saisons sèches au cours de l’année
Il semble que
les saisons des pluies aient désormais un déroulement un peu différent
de ce qu’il était précédemment.
Dans les zones à une comme à
deux saison des pluies, l’une de ces saisons, voire les deux, a une
durée plus courte qu’auparavant. C’est parfois lié au fait que la saison
des pluies débute plus tardivement, parfois au fait qu’elle s’arrête
plus précocement, mais il est pratiquement impossible de généraliser. De
même, le moment auquel cette modification s’est opérée ne peut être
déterminé avec précision. Ce relatif raccourcissement des durées de
saisons des pluies s’inscrit cependant très logiquement dans le cadre de
la baisse de la pluviométrie constatée dans toute la zone.
Modification
de la répartition des quantités précipitées au sein des saisons des
pluies
Apparemment les quantités précipitées annuellement ont
une répartition dorénavant un peu différente de ce qu’elle était
précédemment.
Dans la zone à 1 saison des pluies, les décades
les plus pluvieuses semblent apparaître plus précocement. La saison des
pluies apparaîtrait également plus homogène autour de ces 3 décades.
Dans la zone à 2 saisons des pluies, la pluviométrie enregistrée
au cours des saisons pluvieuses a considérablement varié au cours des
dernières décennies. Globalement elle a diminué. Ce fait est cependant
plus sensible en ce qui concerne la première saison ou "grande saison
des pluies". Il semble que la pluviométrie de la seconde saison ou
"petite saison des pluies" ait, quant à elle, beaucoup fluctué. Elle
semblerait même avoir été relativement forte durant la décennie 1980,
comparativement à ce que l'on observait auparavant, modifiant
ainsi « l’équilibre pluviométrique » précédent.
Modification
des caractéristiques des pluies hors saisons des pluies
Apparemment
les pluies hors saisons des pluies n’ont varié qu’en quantité. Leur
distribution temporelle semble, elle, inchangée.
Les phénomènes
sont plus marqués en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique Centrale. Au sein
des pays de l’Afrique de l’Ouest, ce sont les pays situés à l’Ouest du
Ghana qui sont les plus fortement touchés.
Dans les zones à une
saison sèche, la diminution des quantités précipitées est importante dès
la fin de la décennie 1960. On assiste donc dans ces régions à un «
renforcement » de la saison sèche qui se traduit par la disparition d’un
certain nombre d’événement pluvieux habituellement enregistrés hors
saison des pluies. Certaines zones de forêt subissent ce même phénomène
mais de manière atténuée.
Dans les zones à deux saisons sèches,
les changements concernent particulièrement la « grande saison sèche ».
Celle-ci a vu son cumul pluviométrique diminuer fortement. C’est sur le
littoral Est de la Côte d’Ivoire que le phénomène est le plus marqué.
Par contre la petite « saison sèche » n’a pas connu de changement très
prononcé.
Mise en évidence d’une variabilité pluviométrique
mensuelle
Rappelons tout d’abord que le régime des pluies
découpe la zone d’étude en deux domaines climatiques : équatorial et
tropical. Le premier ne constitue, au Sud, qu’une partie peu importante
de la zone d’étude.
La pluviométrie mensuelle a notablement changé au cours des
dernières décennies en Afrique de l’Ouest et Centrale. Mais le
changement ne s’est pas effectué uniformément sur toute l’année même si,
globalement, sur chacun des mois la pluviométrie a diminué. La figure 5 et la
figure 6 montrent la pluviométrie
interannuelle et les indices pluviométriques de deux mois de
l'année : Février en période sèche et
Juillet en période humide.
L’analyse des résultats
présentés uniquement sur ces deux cartes montre que le phénomène de
sécheresse touche la zone étudiée de manières qui peuvent être très
différentes. Ce qui est conforme aux modifications subies par les
régimes pluviométriques de la région et décrites dans les paragraphes
précédents.
Peu de régions peuvent prétendre avoir échappé à une
baisse des précipitations mensuelles. Certaines régions ont même connu
de très fortes perturbations dans la répartition des précipitations
durant ces dernières décennies : la Côte d’Ivoire en est un parfait
exemple.
Les régions les plus touchées apparaissent comme celles
où habituellement il pleut le plus (de la Guinée à la Côte d’Ivoire) et
celles où, habituellement, il pleut le moins, comme la bordure
sahélienne. Entre les deux, le phénomène de sécheresse et ses
manifestations sont très hétérogènes. En Afrique Centrale, en
particulier, le phénomène n’a pas connu une ampleur comparable à ce
qu’elle est en Afrique de l’Ouest non sahélienne.
Travailler à
un pas de temps mensuel exige une connaissance approfondie du
fonctionnement du climat dans cette région qui apparaît comme très
complexe. Ces études et ces conclusions obtenues sur la pluviométrie
devraient être complétées par la prise en compte d’autres variables
climatologiques afin de permettre une meilleure compréhension du
mécanisme de mise en place du phénomène de sécheresse en Afrique de
l’Ouest et en Afrique Centrale.
Diminution du nombre de jours
de pluie par an
Le nombre annuel de jours de pluie a varié au
cours des dernières décennies en Afrique de l’Ouest et Centrale (figure 7 et figure 8).
Le plus
souvent, on enregistre une diminution importante en Afrique de l’Ouest
et moindre en Afrique Centrale. Il est, cependant, difficile d’être très
précis car les données disponibles ne couvrent pas l’ensemble de la zone
d’étude.
Si l’apparition du phénomène de diminution du nombre annuel de
jours de pluie se manifeste sur une période assez longue (de 1955 à 1980
environ), c’est malgré tout autour de l’année 1970 qu’elle est la plus
fréquente (figure 9). Généralement, ce
phénomène est en concordance avec la baisse constatée des précipitations
annuelles, a fortiori en Afrique de l’Ouest.
Modification au
sein de la distribution de la pluviométrie journalière
La
distribution de la pluviométrie journalière n’a apparemment pas varié au
cours des dernières décennies. On constate, en effet, que la baisse de
la pluviométrie annuelle semble avoir uniformément affecté toutes les «
catégories » de pluviométrie journalière, des plus faibles au plus
importantes.
Néanmoins, quelques ruptures et tendances peuvent
être observées en certains endroits à la fin de la décennie 1960 ou au
début de la décennie 1970, traduisant peut-être un changement plus net à
l’échelle de l’événement pluvieux. Ce type de données relevant de la
pluviographie n’était malheureusement pas accessible d’un point de vue
régional.
Il serait intéressant de poursuivre l’analyse des
jours pluvieux à un pas de temps plus fin, celui de l’événement
pluvieux. La constitution de courbes I.D.F. de part et d’autre de
l’année 1970 apporterait probablement des éléments intéressants quant à
l’éventuelle modification de la distribution des événements pluvieux.
Remarques
- Les résultats d’analyse de certaines variables ne sont pas toujours
aussi nets que ceux obtenus sur la pluviométrie annuelle ou mensuelle
par exemple. Pour ces 2 seules variables, il a été possible d’effectuer
un « vrai » travail de régionalisation car nous disposions de données
sur l’ensemble de la zone d’étude. Dans les autres cas, celle-ci a été
morcelée en sous-zones; ce qui ne facilite pas une analyse régionale.
- Malgré un important travail de critique, certains problèmes qui
sont apparus au cours des traitements réalisés peuvent être liés à la
qualité des données journalières collectées. Certains résultats très
ponctuels, comme une augmentation locale du nombre annuel de jours de
pluie au cours de ces dernières décennies, devront être pris avec
circonspection. Ils ne mettent cependant pas en cause l’ensemble des
résultats acquis par ailleurs.
- Il convient d’insister sur le fait que les résultats obtenus sont
en partie liés aux définitions retenues pour les différentes variables
étudiées. D’autres définitions auraient pu être proposées.
ANALYSE MULTIVARIEE DE LA VARIABILITE PLUVIOMETRIQUE
Toutes les
approches univariées réalisées dans le cadre du programme ICCARE
montrent que l’Afrique de l’Ouest a subi dans les années 60-70 des
modifications climatiques importantes. Les tests statistiques mis en
oeuvre sur chaque site de mesure (test de Pettitt (Pettitt, 1979); test
de segmentation de Hubert (Hubert et al, 1989); procédure bayésienne
(Kotz et al, 1981)) pour différentes variables étudiées (nombre annuel
de jours de pluie, hauteur annuelle de la saison sèche, durée annuelle
de la saison des pluies) concluent à des ruptures en moyenne sur la
plupart des stations de cette région.
Cependant, les résultats
obtenus ponctuellement par poste et par variable, n’ont pas été toujours
faciles à interpréter dans leur ensemble ni à synthétiser. L’objectif
est de réaliser, alors, une analyse spatio-temporelle généralisée au cas
multivarié.
Cette approche tridimensionnelle permettra ainsi
d’une part de détecter des ruptures climatiques caractérisées par
plusieurs variables pluviométriques et d’autre part de répartir
spatialement les postes ayant subi des changements similaires sur une
période commune.
Test de détection d'une rupture en moyenne

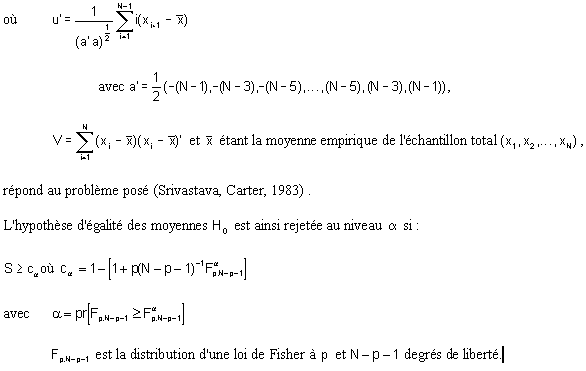
Estimation du point de rupture
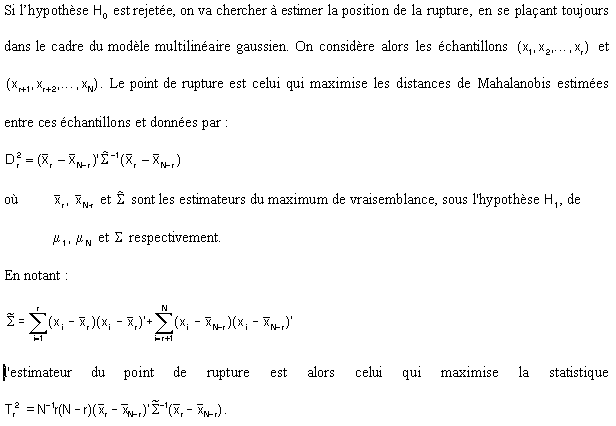
Application aux données
La zone d'étude se situe entre les longitudes 18° Ouest et 28°
Est et les latitudes 2° et 14° Nord. Elle recouvre tous les pays en
bordure du Golfe de Guinée. Cependant, du fait du nombre important de
données manquantes, des pays comme le Nigeria ou le Ghana n'ont pu être
pris en compte.
L’objectif étant de confirmer l'existence de ruptures en moyenne
dans les années 1960 et 1970, l’analyse est restreinte à l’étude des
séries entre 1950 et 1980. Compte tenu du fait que le test utilisé
s'applique aussi bien à des séries longues que courtes
mais qu'il ne peut détecter qu'une seule rupture en moyenne par série,
procéder ainsi permet de ne pas mettre en évidence des
ruptures en moyennes antérieures à celles recherchées.
Quatre variables quantitatives au pas de temps annuel sont
considérées pour chacune des 99 stations pluviométriques
retenues : cumul des pluies, nombre annuel de jours de pluie, durée de
la saison des pluies et hauteur précipitée durant la
saison sèche.
Préalablement à l’étude de détection de rupture,
il convient de résumer l’information brute au moyen d'une méthode
d'analyse des données exploratoire et multidimensionnellequi permet de
constituer des groupes de postes à l’intérieur desquels sont mis en
évidence des comportements similaires.
La méthode exploratoire utilisée est STATIS (Lavit, 1988). Il
s'agit d'une analyse conjointe de plusieurs tableaux quantitatifs, pour
lesquels est recherchée, entre autres, une structure commune appelée
interstructure. Les tableaux sur lesquels est effectuée cette analyse
tridimensionnelle sont représentés sur la figure 10.
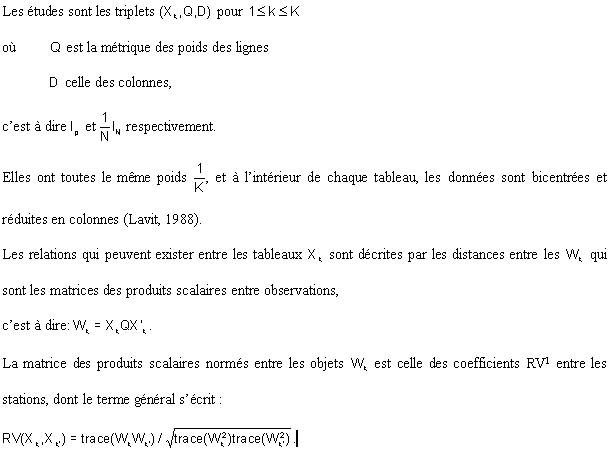
On réalise sur cette
matrice une Analyse en Composantes Principale classique en retenant les
r vecteurs propres correspondant aux r plus grandes valeurs propres afin
d’obtenir une représentation des stations.
Résultats et conclusion
La représentation dans le
premier plan principal (figure 11) permet de
former trois groupes à l’intérieur desquels les postes ont des
comportements similaires.
Sur la figure 12, ont été
reportées les groupes de postes ainsi obtenus :
- groupe I: Togo, Bénin et sud de la Côte d’Ivoire,
- groupe II: Cameroun, Centrafrique et Burkina Faso,
- groupe III: Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali et Sénégal.
L'organisation spatiale des postes fait apparaître nettement
une répartition Nord-Sud d'une part et Est-Ouest d'autre part malgré
l'absence de données sur le Ghana et le Nigeria.
La carte obtenue résume donc les comportements pluviométriques
de l'ensemble des stations de la zone étudiée entre 1950 et 1980, tels
qu'ils ont été décrits à l'aide de quatre variables
hydrologiques. Il est ainsi possible d'associer à chaque groupe de
postes pluviométriques des caractéristiques communes pour lesquelles on
pourra chercher à mettre en évidence des ruptures en
moyenne.
Le test de rupture en moyenne et l'estimation du point de
rupture s’effectuent sur les séries des moyennes intergroupes pour
chaque variable. Les résultats sont regroupés dans le tableau 2 et la figure 13.
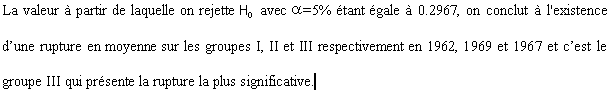
Les résultats de
cette approche viennent ainsi confirmer ceux des études univariées
(Paturel et al, à paraître), à savoir l’existence de ruptures en moyenne
dans les années 1960 et 1970 en Afrique de l’Ouest et Centrale. Les
ruptures détectées en 1967 et 1969 confirment le début d’une période
déficitaire; celle détectée pour le groupe I (Togo, Bénin
et quelques stations du sud de la Côte d’Ivoire) en 1962 ne traduit
qu'un déficit peu significatif. De plus, l’étude spatio-temporelle et
multivariée réalisée, permet de proposer une organisation des postes
pluviométriques, sur toute la durée de l’étudequi traduit des
comportements et des variations climatiques communs.
IMPORTANCE DU DEFICIT PLUVIOMETRIQUE ENREGISTRE ACTUELLEMENT AU
SEIN DE LA CHRONOLOGIE PLUVIOMETRIQUE DU SIECLE
Les
observations pluviométriques disponibles datent souvent du début des
années 1920. Un certain nombre de stations sont suivies, elles, depuis
le tout début du siècle, voire avant (pays anglophones en
particulier).Toutes indiquent clairement que l’Afrique de l’Ouest et
Centrale non sahélienne a connu au cours du 20ème siècle trois périodes
sèches (1910-1922, 1936-1950, 1969 à maintenant) et deux phases humides
(1922-1935 et 1951-1968).
Les séries pluviométriques ont
été traitées dans leur entier. L’étude a été menée
par l’application exclusive du test de Pettitt (Pettitt, 1979).
Le tableau 3 présente la probabilité
associée à la statistique du test calculé pour chacun des postes. Un
classement qualitatif a été effectué en tenant compte des valeurs de
cette probabilité.
Les valeurs de cette probabilité ont été reportées sur une carte
de la région étudiée (figure 14)
: le phénomène de déficit pluviométrique est plus marqué à l’Ouest du
5ème méridien Ouest et au Nord des 8-10èmes parallèles. Ailleurs, ce
phénomène est moins accentué.
Les résultats du test montrent que, dans une grande majorité des
cas, une « rupture » (diminution de la pluviométrie annuelle) au sein de
la série chronologique s’observe entre 1960 et 1979 avec un niveau de
signification qui varie d’un poste à l'autre. Dans seulement 5 cas, la
rupture a été observée en dehors de cette période (autour des années
1940). Il faut noter, également, que, pour 6 postes, le test révèle une
augmentation de la pluviométrie annuelle.
Au cours de ce siècle, la sécheresse actuelle ne semble donc pas
avoir connu d’équivalent tant en durée qu’en intensité. La sécheresse
qui s’en rapproche le plus serait celle de 1910-1922, mais aucune
comparaison n’a pu être réellement effectuée car l’information
pluviométrique est rare entre 1900 et 1920. Cependant les quelques
stations où l’on peut trouver cette information montrent que la
sécheresse de 1910-1922 semble avoir été d’une intensité équivalente à
celle qui sévit actuellement.
Les représentations
cartographiques et certaines analyses liées à la latitude et à la
longitude soulignent l’existence d’une forte hétérogénéité spatiale
quant à l’intensité et à la durée des périodes déficitaires et
excédentaires. On a ainsi pu mettre en évidence que, durant la «
sécheresse » actuelle, c’est dans les régions Nord-Ouest que les
déficits se sont révélés les plus importants. A l’inverse, par exemple,
la « sécheresse » des années 1936-1950, relativement faible sur toute la
région, a été plus fortement ressentie en Afrique Centrale ainsi qu’au
Togo et au Bénin. On notera, par ailleurs, que c’est précisément au
niveau de ces deux derniers pays que la « sécheresse » actuelle passe
par une intensité minimale en Afrique de l’Ouest.
La comparaison
des deux dernières périodes sèches montre que celle qui a débuté à la
fin des années 1960 a connu une extension régionale généralisée, ce qui
ne fut pas le cas de celle de 1936-1950, souvent beaucoup plus localisée
dans ses manifestations.
Par ailleurs, il n’a pas été possible
d’identifier une relation simple à l’échelle interannuelle entre les
phénomènes ENSO et la succession des périodes sèches et humides. Le seul
lien qui puisse être véritablement mis en évidence est la concomitance
entre l’ENSO le plus important du siècle (1982-1983) et une année
particulièrement déficitaire en Afrique de l’Ouest et Centrale (1983).
Néanmoins, la prise en compte des grands modes de la variabilité
climatique pourra, à n’en pas douter, apporter des éléments
d’explication importants relatifs aux variations spatio-temporelles de
la pluviométrie en Afrique de l’Ouest et Centrale, sahélienne et non
sahélienne.
CONCLUSION
Ce projet entrepris dans le cadre du programme FRIEND AOC du
PHI de l'UNESCO a permis d'identifier les manifestations de la
variabilité climatique observée depuis près de vingt cinq ans maintenant
en Afrique de l'Ouest et Centrale. Alors qu'on l'a longtemps cru
cantonné au Sahel, cette étude a montré que le déficit pluviométrique a
également touché les régions forestières et, plus généralement,
l'Afrique dite "humide".
Cette baisse de la pluviométrie a, bien entendu, des
conséquences sur les régimes des cours d'eau et donc sur la
disponibilité des ressources en eau, clé de la réussite de bon nombre de
projets de développement. La variabilité des régimes hydrologiques,
ainsi que l'étude des éventuelles modifications de la relation
pluie-débit, font l'objet des deux phases suivantes du programme ICCARE.
Force est de constater que la simple étude des séries
chronologiques de hauteurs précipitées annuelles fait apparaître une
nette et brutale fluctuation du régime pluviométrique dans toute la
région considérée, à la fin des années 1960 et au début des années 1970.
D'un point de vue général, l'analyse globale de la répartition
de la pluviométrie fait apparaître un tracé des isohyètes assez
irrégulier, en particulier dans les zones côtières de la façade
atlantique et de l'Ouest du Golfe de Guinée. Les secteurs les plus
humides, avec par endroits des précipitations annuelles supérieures à
3000 mm, se trouvent à l'Ouest, sur la côte atlantique, ainsi qu’au Sud
de la Côte d’Ivoire et du Nigeria. La pluviométrie des régions Nord de
la zone étudiée est assez uniforme, l’éloignement par rapport à l’Océan
Atlantique constituant un puissant facteur d’homogénéisation des régimes
pluviométriques.
La cartographie des résultats de l'analyse des séries
chronologiques montre une tendance générale au glissement des isohyètes
vers le Sud/Sud-Ouest, de la décennie 1950 à la décennie 1980. Cette
évolution traduit une diminution nette et généralisée de la pluviométrie
annuelle sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et centrale non
sahélienne :
- Dès la décennie 1970, la zone à pluviométrie inférieure à 1200 mm
s'est étendue vers le Sud, signe d'un important déficit pluviométrique.
Cette tendance s'est encore accrue durant la décennie 1980 au cours de
laquelle cette zone couvrait alors près des deux tiers de la région
étudiée. Certaines régions de savane arborée ont ainsi vu leur régime
climatique modifié, ce qui se traduit par le passage d'un régime
"guinéen" à un régime "soudanais".
- Jusqu'à la fin des années 1960, l'isohyète 1600 mm apparaissait
comme caractéristique d'une pluviométrie moyenne en zone forestière. Dès
les années 1970, cette correspondance n'était plus systématiquement
vérifiée, en particulier dans les forêts tropicales du Sud de la Côte
d'Ivoire, du Cameroun et de Centrafrique. Cette baisse de la
pluviométrie s'est encore accentuée durant la décennie 1980.
- Les régions à forte pluviométrie (plus de 2000 mm par an) sont
également en nette régression. Elles ont même totalement disparu en
certains endroits.
L'emploi de méthodes de détection de ruptures pour étudier
les séries chronologiques confirme la cartographie des résultats issus
de l'analyse des séries pluviométriques. En règle générale, les
différentes procédures appliquées aux séries de hauteurs annuelles
précipitées soulignent l'existence d'une rupture survenue à la fin des
années 1960 ou au début des années 1970, et donc en phase avec ce qui a
été observé et étudié au Sahel. Les déficits pluviométriques
correspondants sont de l'ordre de 20%. Ils atteignent parfois des
valeurs supérieures à 25%, notamment sur la côte atlantique ou dans le
Nord, confirmant ainsi que l'Afrique "humide" a, elle aussi, été
sévèrement touchée par cette variabilité pluviométrique.
L'analyse menée au pas de temps mensuel montre que la baisse de
la pluviométrie est un phénomène qui touche chaque période et chaque
saison de l'année. Peu d'endroits peuvent, en effet, prétendre avoir
échappé à une baisse des précipitations mensuelles. Certaines régions,
telles que la Côte d'Ivoire, ont connu des modifications extrêmement
importantes. Mais d'une manière générale, il apparaît que ce sont les
zones à régime pluviométrique extrême qui ont subi les modifications les
plus importantes : les plus arrosées (de la Guinée à la Côte d'Ivoire)
et les plus arides (la bordure sahélienne au Nord de la zone étudiée).
Entre les deux, le phénomène est d'intensité plus nuancée.
D'autres variables permettant une caractérisation plus
"qualitative" du phénomène ont également été étudiées. Elles apportent
un complément d'information quant aux manifestations de cette
variabilité pluviométrique.
Il apparaît ainsi que le déroulement des saisons des pluies est
légèrement différent de ce qu'il était avant la décennie 1970. Les
saisons des pluies sont généralement plus courtes, soit parce qu'elles
commencent plus tôt, soit parce qu'elles finissent plus tard. De même,
les quantités précipitées durant les saisons des pluies ont désormais
une répartition qui s'est trouvée modifiée. Cela se traduit par une
pluviométrie plus homogène (zone à 1 saison des pluies) ou par une
variation sensible du rapport des hauteurs précipitées des deux saisons
des pluies.
Certaines régions de la zone, et plus particulièrement en
Afrique de l'Ouest, ont également vu une diminution des précipitations
enregistrées hors saison des pluies. Ce phénomène marque un
"renforcement" de la saison sèche qui contribue, tout à la fois, à la
baisse des précipitations annuelles et à la nette perception du
phénomène par les populations. La diminution du nombre annuel de jours
de pluie, là où elle a pu être étudiée, est un corollaire vérifié du
déficit pluviométrique observé.
Une approche statistique complémentaire a été mise en oeuvre qui
consiste en une étude spatio-temporelle des données à l'aide d'une
méthode d'analyse exploratoire multidimensionnelle. Celle-ci a ensuite
conduit à l'utilisation d'un test multivarié de détection de ruptures en
moyenne. Cette approche confirme les résultats des analyses univariées,
tant du point de vue des dates de rupture (fin des années 1960, début
des années 1970) que de l'hétérogénéité spatiale et temporelle du
phénomène. L'existence de deux axes privilégiés d'hétérogénéité, le
premier Nord-Sud et le second Est-Ouest, apparaît, en effet, comme l'une
des caractéristiques majeurs de ce déficit pluviométrique persistant.
L'examen des séries chronologiques depuis l'origine des stations
a permis de resituer l'événement observé dans une perspective
historique. Il apparaît ainsi que, depuis le début du siècle, la région
a connu une succession de périodes sèches et humides, sans que l'on
puisse toutefois parler de cycles. Le phénomène observé à la fin des
années 1960 et au début des années 1970 apparaît, cependant comme le
plus significatif du point de vue statistique. Cette période
déficitaire, toujours d'actualité, présente, en outre, une durée et une
intensité tout à fait remarquables. En particulier dans les secteurs
Ouest et Nord de la zone étudiée, où le phénomène revêt un caractère
exceptionnel, ce qui n'est sans doute pas le cas plus à l'Est.
Si les causes premières d'apparition de cette baisse de la
pluviométrie et de ses conséquences restent, à l'heure actuelle,
difficilement explicables, certaines activités humaines ont, sans aucun
doute, contribué à accentuer le phénomène. En effet, si la déforestation
ne peut pas être tenue comme cause principale de la sécheresse, la
surexploitation de la forêt dans bon nombre de régions bordant l'Océan
Atlantique et le Golfe de Guinée a très certainement participé à
accroître les déficits pluviométriques.
Cette baisse de la pluviométrie a, bien entendu, des
conséquences importantes sur la disponibilité des ressources en eau dans
ces régions. L’agriculture, l’alimentation des retenues et la production
hydroélectrique, entre autres, sont fortement pénalisées par cette
diminution des ressources. Les conséquences de ce phénomène sont donc
très inquiétantes en ce qui concerne le bon fonctionnement et la
rentabilité des projets déjà réalisés ou envisagés.
Si la carence pure et simple n’est pas à craindre dans ces
régions où les quantités précipitées restent importantes dans l’absolu,
les effets de cette variabilité climatique peuvent, malgré tout, se
révéler désastreux, en ce sens qu’ils modifient les données d’un
équilibre déjà souvent mis à mal par ailleurs (pression anthropique et
déforestation par exemple).
L'étude des modifications intervenues au sein des régimes
hydrologiques, permettra d'apporter certaines réponses quant à
l'incidence de ce déficit pluviométrique sur la disponibilité des
ressources en eau.
DEBUT DE LA PAGE