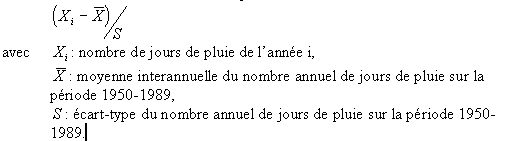Volet pluviométrie
Le présent rapport a trait au volet pluviométrie du programme
ICCARE. La variable que nous allons traiter est le nombre annuel de
jours de pluie. La question à laquelle ce rapport essaye d’apporter une
ou plusieurs réponses est
observe-t on une diminution
du nombre de jours de pluie par an?
L’échelle de présentation des résultats est celle de la région
étudiée.
DONNEES ET METHODES
Les données sont des nombres annuels de jours de pluie sur
l’ensemble des pays. La majeure partie de l’information récoltée est
contenue dans la base « PLUVIOM » gérée à Montpellier par l’ORSTOM. Le
complètement de cette base s’est heurté à beaucoup de problèmes :
- Nous n’avons pas toujours pu disposer d’une information
pluviométrique journalière nécessaire pour ce travail.
- Lorsque l’information pluviométrique journalière existe, elle
s’accompagne parfois d’erreurs manifestes de saisie : rosée comptée
comme pluie; cumul de pluie signalé incorrectement, ... Ces remarques
s’appliquent d’ailleurs également à la banque « PLUVIOM » de l’ORSTOM.
Nous avons donc décidé de reprendre les résultats du travail confié à
l’ASECNA et l’ORSTOM par le CIEH pour la publication de tous les relevés
de précipitations journalières jusqu’en 1980 aux stations
pluviométriques. Au cours de ce travail, de nombreuses critiques ont été
faites sur les données. Cela nous a permis de constituer notre propre
banque. Grâce à des contacts avec des services nationaux et d’autres
équipes de recherche (qu’ils en soient tous remerciés!), nous avons
complété celle-ci lorsque les données nous apparaissaient suffisamment
fiables.
La sélection des postes analysés repose sur des critères de
qualité des données et de longueur des séries. Nous tenons à signaler
qu’au cours de ce travail, nous avons été confrontés sur certains postes
à des résultats parfois très surprenants. Nous les avons soit rejetés,
soit repris en tant que tel mais il convient de se montrer circonspect
par rapport aux résultats obtenus.
L’information retenue ne couvre ni l’ensemble de la zone
étudiée, ni toute la période d’étude (décennies 1950, 1960, 1970 et
1980). Le traitement complet sur les 4 décennies n’a pu être effectué
que sur le Sénégal, la Guinée Bissau, le Mali, la Côte d’Ivoire, le
Burkina Faso et le Bénin.
Le travail a été effectué sous deux angles différents mais
complémentaires :
- à un niveau ponctuel, pour chaque station, nous avons utilisé des
méthodes statistiques qui permettent de caractériser des fluctuations
dans une série chronologique.
- Les méthodes statistiques retenues dans le cadre de ce travail sont
: test de corrélation sur le rang pour vérifier le caractère aléatoire
d’une série, test de Pettitt, statistique de Buishand, ellipse de
contrôle, procédure bayésienne de Lee et Heghinian et procédure de
segmentation des séries hydrométéorologiques de Hubert pour détecter une
rupture au sein d’une série (Lubès et al, 1994).
- Lorsque les tests statistiques donnent des résultats
contradictoires nous parlerons « d’anomalie »; lorsque les tests donnent
les mêmes résultats nous parlerons de « rupture ».
- A un niveau régional, nous avons cartographié l’évolution du nombre
annuel de jours de pluie sur les décennies 1950, 1960, 1970 et 1980.
- Pour chacune des décennies, la variable brute a été cartographiée,
à chaque fois à partir des mêmes postes, sur la zone étudiée. Nous avons
produit deux types de carte : une carte de tracé des courbes isovaleurs
du nombre annuel de jours de pluie et une carte ne regroupant que
quelques courbes isovaleurs afin de donner une représentation plus
accessible des fluctuations de la variable nombre annuel de jours de
pluie.
- Sur chacun des postes retenus, nous avons déterminé un indice
calculé de manière similaire à « l’indice pluviométrique » (Nicholson et
al, 1988; Servat, 1994). L’indice utilisé ici est une moyenne par
décennie des indices annuels calculés selon l’expression :
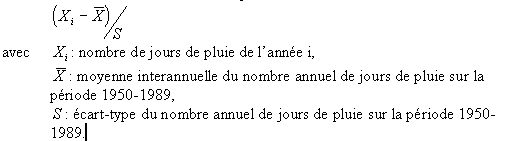
Pour chacune des décennies, cet indice a été cartographié, à
chaque fois à partir des mêmes postes. La carte alors obtenue traduit
des zones à déficit ou excédent annuel de jours de pluie plus ou moins
marqué.
CARTOGRAPHIE DES VARIATIONS DU NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE PLUIE
La figure 1 présente la localisation des
postes utilisés.
Les tracés des courbes isovaleurs du nombre
annuel de jours de pluie (figure 2) sont
plus complexes que ceux des hauteurs annuelles de pluie, en particulier
à l’Est de cette zone d’étude. Cependant, en certains endroits de la
zone étudiée, ils se ressemblent beaucoup et on retrouve les mêmes
caractéristiques :
- Effet pluviogène des massifs montagneux : sur la décennie 1950, on
mesure l’influence de la chaîne de l’Atakora au Togo et au Bénin sur le
tracé des courbes isovaleurs; sur les contreforts Est du massif du Fouta
Djalon, la variable diminue.
- Effet pluviogène de la végétation : le « V Baoulé » (limite de la
forêt et de la savane) en Côte d’Ivoire infléchit fortement le tracé des
courbes isovaleurs.
- Les zones côtières sont les zones arrosées le plus fréquemment sur
la zone étudiée.
- Les zones non soumises à l’influence maritime ont un tracé de
courbes isovaleurs qui ont un gradient voisin d’un axe Nord-Sud.
Les tracés à l’Est de la zone d’étude montrent l’existence d’un
grand nombre d’extrema, surtout en Centrafrique. Ceux-ci ne s’expliquent
pas toujours même si le pays a été et demeure toujours recouvert dans sa
partie méridionale par une forêt tropicale dense dont la limite a varié
au cours des dernières décennies.
Les cartes de nombre de jours de pluie interannuel (figure 3) montrent que la variable étudiée a diminué au cours des
décennies en Afrique de l’Ouest alors qu’elle semble être plus stable
sur les pays de l’Afrique Centrale. Il est vrai que pour ceux-ci, nous
ne disposons pas de données sur la dernière décennie écoulée.
Le nombre de jours de pluie semble avoir diminué à partir de la
décennie 1970. Les pays au Nord de la zone d’étude (Sénégal, Mali,
Burkina Faso et Tchad), ainsi que les massifs forestiers de Guinée et de
Côte d’Ivoire sont les premiers concernés par ce phénomène. Au cours de
la décennie 1980, celui-ci s’accentue et touche alors le Bénin.
Les cartes d’indices (figure 4)
permettent de visualiser l’ampleur du phénomène de baisse du nombre
annuel de jours de pluie tant en intensité qu’en extension. Ces cartes
n’ont pu être dressées ni pour les pays d’Afrique Centrale, ni pour la
Guinée Conakry et le Togo puisque la période de référence servant au
calcul de la moyenne regroupe les 4 décennies.
Ces cartes confirment les observations faites ci-dessus : à
partir de la décennie 1970, une diminution du nombre annuel de jours de
pluie apparaît et s’accentue durant la décennie 1980.
Très rares sont les zones échappant à ce phénomène. Nous
émettrons quelques doutes sur les résultats des stations de Pô et de
Ouahigouya, au Burkina Faso, et de Katibougou au Mali.
TESTS DE DETECTION DE RUPTURES DANS LES SERIES CHRONOLOGIQUES DU
NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE PLUIE
Si l’on s’intéresse dans un premier temps à la vérification du
caractère aléatoire de chacune des séries chronologiques (figure 5), on observe que les séries chronologiques ont un
caractère plus généralement non aléatoire en Afrique de l’Ouest et
aléatoire en Afrique Centrale. Dans le cas où l’hypothèse alternative
d’une tendance est acceptée, celle-ci se traduit le plus souvent par une
diminution du nombre annuel de jours de pluie. Toutefois sur certains
postes, elle se traduit par une augmentation de la variable (on peut
s’interroger sur la validité de ce résultat, comme il est mentionné en
annexe).
Si l’on s’intéresse ensuite à la détection d’une rupture ou d’une
anomalie au sein de chacune des séries chronologiques (figure 6), on observe que la majorité des ruptures est concentrée
en Afrique de l’Ouest. En Afrique Centrale, on trouve en plus grande
proportion des postes pour lesquels, soit aucune rupture n’a été
détectée, soit le résultat obtenu est une anomalie.
On constate que généralement les méthodes de vérification du
caractère aléatoire et celles de détection de ruptures donnent des
résultats concordants. Toutefois, en Afrique Centrale, les différentes
méthodes se contredisent parfois : pour une série donnée, l’hypothèse du
caractère aléatoire est acceptée alors que certaines méthodes détectent
une rupture. On peut peut-être traduire cela par un changement peu
marqué au sein des séries chronologiques.
Une modification au sein des séries de nombre annuel de jours de
pluie se fait surtout ressentir dans la partie Ouest de la zone d’étude.
Ce changement se traduit le plus souvent par une diminution importante
du nombre annuel de jours de pluie. Parfois il se traduit par une
augmentation de celui-ci.
C’est généralement au cours de la première moitié de la période
d’étude que l’on observe les quelques augmentations de la variable (figure 7). Quand à la diminution de celle-ci; elle se manifeste
fréquemment autour de l’année 1970, mais moins nettement que pour la
pluviométrie annuelle.
CONCLUSION
A la question posée en introduction, la réponse est qu’effectivement
le nombre annuel de jours de pluie a changé au cours des dernières
décennies en Afrique de l’Ouest et Centrale.
Le plus souvent, on enregistre une diminution importante en
Afrique de l’Ouest et moindre en Afrique Centrale. Il est difficile
d’être très précis car les données disponibles ne couvrent pas
l’ensemble de la zone d’étude.
Les augmentations observées pour certains des postes
pluviométriques doivent être considérées avec circonspection.
L’apparition du phénomène de diminution du nombre annuel de
jours de pluie se manifeste sur une période assez longue (de 1955 à 1980
environ). Mais c’est autour de l’année 1970 qu’elle est la plus
fréquente.
Nous avons essayé d’analyser de façon plus approfondie la baisse
de la pluviométrie annuelle par le biais du nombre annuel de jours de
pluie. Si, bien souvent, il y a une forte corrélation entre la baisse de
la pluviométrie annuelle et la baisse du nombre annuel de jours de
pluie, ce n’est pas systématique (nombreux extrema en Afrique Centrale,
augmentation de la variable au cours des décennies sur quelques postes,
...). Il est difficile d’incriminer entièrement la mauvaise qualité des
données pour expliquer un tel comportement occasionnel.
Résultats par pays
BENIN,
BURKINA FASO, CAMEROUN,
COTE D'IVOIRE,
GUINEE CONAKRY, GUINEE
BISSAU, MALI, REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE, SENEGAL et GAMBIE, TCHAD et TOGO
DEBUT DE
LA PAGE