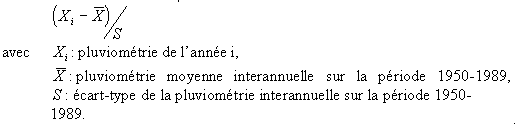Volet pluviométrie
Le présent rapport a trait au volet pluviométrie du programme
ICCARE. Les variables traitées constituent, donc, des séries
chronologiques de pluies. La question à laquelle ce rapport essaye
d’apporter une ou plusieurs réponses est :
peut-on
constater un changement de la pluviométrie annuelle au cours des
dernières décennies?
A cette question peuvent s’ajouter bien d’autres interrogations.
Si il y a eu une modification, quelle a été son ampleur dans la zone
étudiée? A quel moment ce phénomène s’est il déclaré? A-t-il-eu une
forte extension? Cette extension, est-elle uniforme dans l’espace? Si il
n’y a pas eu de modification, la ressent-on tout de même un peu dans les
pays qui bordent le Sahel ou n’est elle propre qu’aux pays sahéliens?
L’échelle de présentation des résultats est celle de la région
étudiée.
DONNEES ET METHODES
Les données sont des valeurs annuelles de pluviométrie sur
l’ensemble des pays. La majeure partie de l’information récoltée est
contenue dans la base « PLUVIOM » gérée à Montpellier par l’ORSTOM.
Grâce à des contacts avec des services nationaux et d’autres équipes de
recherches (qu’ils en soient tous remerciés!), nous avons pu compléter
la base. Nous disposons à l’heure actuelle, d’une base très complète qui
couvre l’ensemble de la zone étudiée et ce, depuis l’implantation des
postes pluviométriques jusqu’à la fin de la décennie 1980.
La
sélection des postes analysés repose sur des critères de qualité des
données et de longueur des séries pluviométriques. La quantité
d’information retenue varie beaucoup d’un pays à l’autre. Elle est très
faible sur la Sierra Leone et le Liberia.
Le travail a été
effectué sous deux angles différents mais complémentaires :
- à un niveau ponctuel, pour chaque station, nous avons utilisé des
méthodes statistiques qui permettent de caractériser des fluctuations
dans une série chronologique.
- Les méthodes statistiques retenues dans le cadre de ce travail sont
: test de corrélation sur le rang pour vérifier le caractère aléatoire
d’une série, test de Pettitt, statistique de Buishand, ellipse de
contrôle, procédure bayésienne de Lee et Heghinian et procédure de
segmentation des séries hydrométéorologiques de Hubert pour détecter une
rupture au sein d’une série (Lubès et al, 1994).
- Lorsque les tests statistiques donnent des résultats
contradictoires nous parlerons « d’anomalie »; lorsque les tests donnent
les mêmes résultats nous parlerons de « rupture ».
- à un niveau régional, nous avons cartographié l’évolution de la
pluviométrie annuelle sur les décennies 1950, 1960, 1970 et 1980 :
CARTOGRAPHIE DES VARIATIONS DE LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE
La figure 1 présente la localisation des
postes utilisés.
Le tracé des isohyètes (figure
2) sur les 4 décennies révèle ou confirme plusieurs points :
- Sur la façade océanique la pluviométrie est importante.
Grossièrement, les isohyètes suivent la côte. Seule exception, du Ghana
au Bénin, où le tracé est plus complexe. De part et d’autre du « Cap des
trois pointes » situé à la pointe méridionale du Ghana, le total des
précipitations annuelles est très différent, élevé à l’Ouest et faible à
l’Est. Une des raisons qui est souvent avancée est l’orientation de la
côte qui est plus parallèle aux flux de mousson et est donc moins
favorable aux précipitations.
- Le massif de l’Atakora qui s’étend du Sud du Ghana et du Togo
jusqu’au Nord-Ouest du Bénin ainsi que le plateau central du Nigeria ont
un effet pluviogène. L’isohyète 1250 mm suit parfaitement leurs contours
respectifs.
- Le « V Baoulé » (limite de la zone de forêt) en Côte d’Ivoire qui
creuse le tracé des isohyètes montre l’effet pluviogène de la zone
forestière.
- L’intérieur du continent, qui n’est pas soumis à l’influence
océanique, où le relief est pratiquement absent et où pousse la savane,
a des isohyètes qui suivent les parallèles.
L’effet pluviogène des massifs montagneux (Atakora et plateau
central du Nigeria) semble s’atténuer fortement pendant la décennie
1980. Parallèlement, dans le sud forestier ivoirien, on constate un
glissement des isohyètes vers le Sud/Sud-Ouest. Ce phénomène, qui se
traduit par une diminution de la pluviométrie dans cette région peut
être lié à une intensification de la déforestation et de la mise en
culture depuis la décennie 1970. Sur la façade océanique, les isohyètes
apparaissent moins resserrées durant la décennie 1980 que durant la
décennie 1950 : les écarts pluviométriques sont alors moindres entre la
côte et l’arrière-pays.
Globalement la pluviométrie a baissé sur
l’ensemble de la zone étudiée et ce, à partir de la décennie 1970.
Durant la décennie 1980, le phénomène semble s’être intensifié. On
notera que durant la décennie 1960, la pluviométrie a été la plus forte
sur quatre des pays qui bordent le Golfe de Guinée : Côte d’Ivoire,
Ghana, Togo et Bénin. Ailleurs, les pluviométries annuelles de la
décennie 1950 et de la décennie 1960 sont assez voisines, voire plus
élevées en ce qui concerne la première (exemples du Sénégal, de la
Guinée Bissau, du Mali et du Burkina Faso).
Les cartes de
pluviométrie interannuelle (figure 3)
illustrent ces observations.
La zone à faible pluviométrie
(inférieure à 800 mm) couvre dorénavant entièrement le Nord de la zone
d’étude : son extension fut minimale durant la décennie 1950, elle fut
maximale durant la décennie 1980, quoique déjà très importante durant la
décennie 1970.
La zone à pluviométrie immédiatement supérieure
(comprise entre 800 et 1200 mm) a glissé fortement vers le Sud. Au cours
de la décennie 1980, les effets pluviogènes des massifs de l’Atakora au
Togo et Bénin et du Plateau Central au Nigeria ne se font plus guère
ressentir.
La zone à pluviométrie intermédiaire (comprise entre
1200 et 1600 mm) a connu une extension maximale durant la décennie 1960.
Au cours de la décennie 1980, elle n’occupe plus qu’une superficie
réduite et est décalée vers le Sud.
Les zones à pluviométrie
plus importante (supérieure à 1600 mm) ont fortement régressé : elles
ont, pour ainsi dire, disparu sur la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau et
la Centrafrique.
Les cartes d’indices pluviométriques (figure 4) permettent de visualiser l’ampleur du phénomène de baisse
de la pluviométrie tant en intensité qu’en extension.
Globalement,
sur l’ensemble de la zone étudiée, les décennies 1950 et 1960 sont
excédentaires par rapport aux décennies 1970 et 1980.
La
décennie 1950 est la décennie la plus pluvieuse à l’exception des
quelques pays cités plus haut auxquels on peut ajouter une partie du
Nigeria, du Cameroun et de la Centrafrique. Le déficit pluviométrique
apparaît au cours de la décennie 1970. Quelques régions très localisées
y échappent : axe Sud-Ouest/Nord-Est au Nigeria, Nord-Ouest de la Côte
d’Ivoire, chaîne de l’Atakora au Togo et centre du Cameroun. Au cours de
la décennie 1980, le phénomène s’étend avec une intensité souvent plus
importante. Celle-ci est forte à l’Ouest et au Nord de l’ensemble de la
zone étudiée ainsi qu’au Nord de la Centrafrique. Les régions côtières
de Côte d’Ivoire sont également très touchées.
En bordure du
Golfe de Guinée, le Togo, le Bénin, le Nigeria et le Cameroun sont moins
affectés par la baisse de la pluviométrie.
Le Cameroun et la
Centrafrique pourraient se situer en limite Sud de la zone d’extension
de cette variation climatique. Une étude complémentaire devrait être
menée dans les régions équatoriales et subéquatoriales pour confirmer ou
non cette hypothèse.
TESTS DE DETECTION DE RUPTURES DANS LES SERIES CHRONOLOGIQUES DE
PLUVIOMETRIE ANNUELLE
Si l’on s’intéresse dans un premier temps à la vérification du
caractère aléatoire de chacune des séries chronologiques (figure 5), on observe :
- Les séries pluviométriques ont un caractère non aléatoire en
Afrique de l’Ouest, au Nord du Nigeria et de la Centrafrique, au Tchad
et au centre du Cameroun. L’hypothèse alternative d’une tendance au sein
des séries pluviométriques peut donc être acceptée. Celle-ci se fait
toujours dans le sens de la diminution de la pluviométrie annuelle.
- Les séries pluviométriques ont un caractère aléatoire
principalement sur la façade océanique à l’Est du Ghana. Toutefois dans
certaines régions plus continentales, on constate une situation
similaire : Est de la Côte d’Ivoire, centre du Ghana, du Togo et du
Bénin ainsi que Sud du Nigeria et de la Centrafrique.
Si l’on s’intéresse ensuite à la détection d’une rupture ou
d’une anomalie au sein de chacune des séries chronologiques (figure 6), on observe :
- Les ruptures concernent principalement les séries pluviométriques
des postes de l’Afrique de l’Ouest. A l’Est de la Côte d’Ivoire et du
Ghana, celles-ci ne concernent plus que le Nord de la zone d’étude ainsi
que des régions assez localisées.
- Les anomalies au sein des séries pluviométriques se font plus
nombreuses à l’Est de la Côte d’Ivoire et du Ghana. Hormis les littoraux
togolais et béninois, elles ne délimitent pas à proprement parler des
zones homogènes. Ces anomalies sont généralement situées à proximité de
postes pour lesquels des ruptures ont été détectées.
- Les postes où ni rupture ni anomalie n’ont été détectées se
trouvent majoritairement dans la partie Est de la zone d’étude,
principalement sur la façade océanique et au Sud.
Une modification au sein des séries pluviométriques annuelles
se fait donc surtout ressentir à l’Ouest et au Nord de la zone d’étude.
Ailleurs, celle-ci n’apparaît que de façon très ponctuelle. Cette
variation, qui se traduit par une baisse importante de la pluviométrie
au cours des dernières décennies, se situe principalement à la fin de la
décennie 1960 et au tout début de la décennie 1970 comme le montre la
figure 7.
CONCLUSION
A la question posée en introduction, la réponse est qu’effectivement
la pluviométrie annuelle a changé au cours des dernières décennies en
Afrique de l’Ouest et Centrale.
Les précipitations annuelles ont
diminué de façon très importante sur l’Ouest et le Nord de la zone
d’étude, ainsi que sur la façade océanique de la Côte d’Ivoire. Ailleurs
ce phénomène a été ressenti mais de manière moins intense.
Cette
variation semble être apparue à la fin de la décennie 1960 et au tout
début de la décennie 1970. Cela fait donc maintenant plus de deux
décennies qu’elle perdure. Elle semble même s’être intensifiée durant la
décennie 1980.
Dans l’état actuel des connaissances, les raisons
d’un tel phénomène ne sont pas déterminées. Il est toutefois intéressant
de noter en Côte d’Ivoire la coïncidence et la concomitance entre la
baisse de la pluviométrie dans le sud forestier d’une part et la
déforestation et la mise en culture de cette région d’autre part. Ceci
est conforme au consensus qui semble se dégager à propos de l’influence
humaine sur le climat (Houghton, 1996).
La poursuite de cette
étude pourrait se faire dans plusieurs directions mais nous avons choisi
d’en privilégier deux :
- Replacer dans « l’histoire » du continent ce phénomène par une
analyse sur des séries pluviométriques les plus longues possibles.
- Analyser de façon plus fine ce phénomène afin d’en déterminer les
manifestations les plus sensibles telles que le raccourcissement de la
(des) saison(s) des pluies ou la diminution du nombre annuel de jours de
pluie.
Résultats par pays
BENIN,
BURKINA FASO, CAMEROUN,
COTE D'IVOIRE, GHANA,
GUINEE CONAKRY, GUINEE
BISSAU, LIBERIA et SIERRA LEONE, MALI, NIGERIA, REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE, SENEGAL et GAMBIE, TCHAD et TOGO
DEBUT
DE LA PAGE